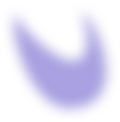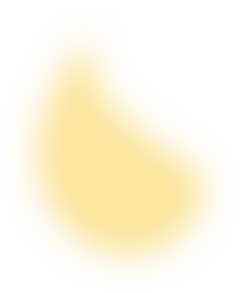Le 9 juin 2023, le juge administratif Pierre-Étienne Morand, du Tribunal administratif du travail (le « TAT ») rend la décision Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc.1 (la « Décision »), selon laquelle le Réseau de transport de la Capitale (le « RTC ») n’est pas assujetti à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève, en application du Code du travail2.
Cette Décision marque un tournant important en ce qu’elle renverse un historique de quatre décennies d’assujettissement du RTC au maintien des services essentiels.
Manifestation de l’évolution de la jurisprudence depuis la consécration constitutionnelle du droit de grève par la Cour suprême du Canada en 2015, ce renversement témoigne également de la compétence restreinte du TAT dans l’interprétation de la notion de « services essentiels » au sens du Code du travail.
Le droit constitutionnel de grève
Le 30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada rendait l’historique arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan3 (l’arrêt « Saskatchewan ») où la Cour suprême reconnaît que la liberté constitutionnelle d’association, consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), protège le droit des salariés de prendre part à un processus véritable de négociation collective, processus dont le droit de grève est une composante essentielle. En effet, selon les juges majoritaires, sans le droit de grève, le droit constitutionnel de négocier collectivement perd tout son sens.
La Cour suprême rappelle également que la définition de « services essentiels » doit être conforme aux normes justificatrices d’atteinte décrites à l’article premier de la Charte. Dans ce contexte, un service essentiel en est un dont l’interruption menacerait de causer un préjudice grave au public en général ou à une partie de la population. Cette notion doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, de sorte que le seul fait que la population subisse des inconvénients n’est pas suffisant pour qualifier un service d‘ « essentiel » justifiant le retrait du droit constitutionnel de grève.
La compétence du TAT
Historiquement, au Québec, les services essentiels étaient déterminés par décret du gouvernement. C’est ainsi que l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève de transport en commun routier avait été décrétée dans les plus grandes villes du Québec, soit Montréal, Laval, Longueuil et Québec, qui ont une population supérieure à 350 000 habitants, parce qu’il a été jugé qu’il pourrait y avoir une augmentation du trafic automobile au point d’empêcher la circulation des véhicules d’urgence.4
Toutefois, en réaction à la consécration constitutionnelle du droit de grève et l’interprétation restrictive des services essentiels prescrits par l’arrêt Saskatchewan, le Code du travail a été modifié5. Le TAT a dorénavant la compétence d’enquête et de détermination de l’assujettissement des services publics, ou entreprises assimilables à un service public, à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève.6
La Décision
La Décision concernant le RTC, qui dessert la ville de Québec, marque la première fois que le TAT étudie l’assujettissement au maintien de services essentiels d’un service de transport en commun desservant une ville de plus de 350 000 habitants.
D’entrée de jeu, le TAT, sous la plume du juge administratif Pierre-Étienne Morand, indique que le transport en commun n’est pas un service essentiel comme tel, mais qu’il pourrait être assujetti au maintien de services essentiels en raison des conséquences découlant de l’interruption d’un tel service.7
Puis, la consécration du droit de grève comme une composante essentielle de la liberté d’association constitue un changement juridique majeur qui oblige une interprétation réellement restrictive des services essentiels. Ainsi, la seule limitation possible du droit constitutionnel de grève est celle où il y aurait danger à la santé ou à la sécurité publique.
Devant ce critère unique, le « seuil » historique de 350 000 habitants n’a pu lieu d’être. La taille de la ville n’a donc aucune pertinence dans l’évaluation de l’assujettissement au maintien de services essentiels. En effet, selon le TAT, s’appuyant des enseignements de la Cour suprême, il ne faut pas confondre « danger » avec « risque », puisque seul le premier s’applique. C’est donc uniquement devant la preuve concrète d’un danger imminent, évident et réel que le droit constitutionnel de grève pourrait être retiré.
Le TAT s’adonne alors à une évaluation très factuelle de la preuve soumise. Chacune des parties présente des rapports ou hypothèses de l’achalandage advenant une grève du transport en commun. Le syndicat soumet diverses solutions de rechange, tels la marche, le vélo, le taxi ou le covoiturage. Le TAT conclut qu’il n’y a pas de présence de « danger » au sens du Code du travail, donnant lieu à assujettir le RTC au maintien de services essentiels :
[24] En effet, la preuve que soumet le RTC n’étaye pas un tel danger imminent, évident et réel, particulièrement parce qu’elle repose sur des hypothèses. Elle néglige de considérer la réalité concrète – caractérisée notamment par la capacité d’adaptation des intervenants des services d’urgence qui exercent leur profession dans des conditions appelées à changer en temps réel –, les différentes solutions de rechange à l’utilisation de l’autobus (à l’exception de l’automobile), l’implantation du télétravail et la facilité d’y recourir ainsi que la flexibilité qu’il procure, le rôle des autorités publiques pour contrôler les flux de circulation, mais aussi dans la communication de l’information.
[25] En outre, il n’y a aucune preuve relativement à la mise en danger de la santé ou de la sécurité de la population en lien avec l’accès des personnes désavantagées sur le plan socioéconomique aux établissements de santé, à l’augmentation du nombre de blessés sur la route ou encore à la détérioration de la qualité de l’air.
[Nos soulignements]
Le TAT rappelle également que le seul fait que le public subisse des inconvénients n’est pas suffisant pour déterminer qu’il s’agisse d’un service essentiel, puisque « la grève a justement vocation à déranger ».
Pour ces motifs, le RTC et le Syndicat ne sont pas assujettis au maintien de services essentiels en cas de grève.
Commentaires
La Décision marque un tournant intéressant en ce qu’il s’agit de la première fois que le TAT rejette entièrement et explicitement la considération du nombre d’habitants de la population desservie, soit le « seuil » de 350 000 habitants, dans l’évaluation de l’assujettissement au maintien de services essentiels d’un réseau de transport en commun routier. Il y a donc confirmation que seule l’interprétation restrictive de « services essentiels », selon laquelle l’interruption d’un tel service présente un danger à la santé et sécurité du public, est retenue.
Cela s’inscrit ainsi dans le mouvement jurisprudentiel de reconnaissance de la primauté du droit constitutionnel de grève depuis l’arrêt Saskatchewan en 2015.
À cet effet, il est intéressant de souligner que dans un tout récent jugement8, la Cour supérieure de l’Ontario invalide une loi9 qui qualifie de service essentiel le réseau de transport en commun de la ville de Toronto et interdit à ses salariés de recourir à la grève comme outil de négociation. Appliquant une interprétation restrictive de la notion de « services essentiels », le tribunal en vient à la conclusion que l’interruption du service ne présente pas un danger de préjudice grave. En effet, bien que le réseau de transport en commun de Toronto soit le troisième plus grand en Amérique du Nord, aucune preuve factuelle ne démontre qu’une grève aurait pour effet d’entraîner un danger à la santé et la sécurité du public.
Force est de constater qu’à l’ère de la consécration du droit constitutionnel de grève, le TAT applique de façon restrictive le critère établi par la Cour suprême. C’est donc uniquement en présence d’une preuve factuelle probante de danger à la santé ou sécurité du public en cas de grève que les tribunaux détermineront qu’il y a lieu d’assujettir le transport en commun au maintien de services essentiels.
-------------------------------------------------------
[1] 2023 QCTAT 2525
[2] RLRQ c C-27
[3] 2015 CSC 4
[4] Voir : Autobus Fleur de Lys, division Shawinigan inc. et Syndicat des salariés d'entreprises en transport par autobus de la région de la Mauricie-Centre-du-Québec (CSD), 2020 QCTAT 2619, par. 16
[5] Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic, LQ 2019, c 20.
[6] Article 111.0.17 du Code du travail
[7] Précité note 1, par. 2 et 35.
[8] ATU Local 113 v. HMQRO, 2023 ONSC 3618
[9] Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto, L.O. 2011, chap. 2 - Projet de loi 150