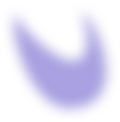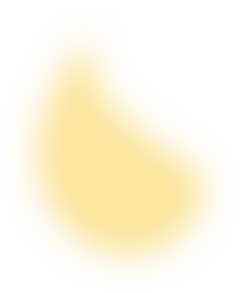Un travailleur agricole utilise le véhicule de l’employeur pour se rendre à une partie de soccer en dehors des heures de travail. Une crevaison survient et en voulant changer le pneu, le travailleur décède tragiquement, le véhicule l’écrasant en raison d’un cric défectueux. Le décès du travailleur résultait-il d’un accident de travail?
La Cour d’appel, dans une décision rendue le 31 juillet 2025[1], a reconnu que le décès de M. Ottoniel Lares Batzibal constitue une lésion professionnelle survenant à l’occasion du travail, accordant ainsi une indemnisation à la succession.
M. Batzibal, travailleur agricole saisonnier guatémaltèque, est décédé en juillet 2021 alors qu’il tentait de réparer un pneu sur un véhicule appartenant à son employeur, en dehors de la journée de travail. Dans le cadre de ses fonctions, il était autorisé à conduire les véhicules de l’employeur. Le travailleur s’était affairé à réparer un pneu crevé après avoir conduit ses compagnons de travail à une partie amicale de soccer en soirée. Il est ensuite retourné sur les lieux de l’employeur pour effectuer la réparation, moment où le drame s’est produit.
Initialement, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le TAT avaient conclu que le décès ne constituait pas une lésion professionnelle, estimant que l’accident n’était pas survenu à l’occasion du travail au sens de la LATMP. Cette décision fut confirmée par la Cour supérieure, qui rejeta le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par la succession du travailleur.
La Cour d’appel, dans une décision majoritaire rendue par les juges Dutil et Bich, a infirmé ce jugement, estimant que le TAT avait adopté une interprétation trop restrictive de la notion « à l’occasion du travail ». Le décès de M. Batzibal est donc reconnu comme un accident survenu à l’occasion du travail, ouvrant droit à l’indemnisation de sa succession. La juge Savard est dissidente.
Cette décision s’inscrit dans une tendance récente des tribunaux à adopter une vision plus large de la notion « à l’occasion du travail », en tenant compte des transformations des milieux et des attentes envers les travailleurs. Dans une publication parue en 2025, nous avions d’ailleurs analysé la notion d’« accident à l’occasion du travail », en soulignant qu’il s’agit d’un concept jurisprudentiel en constante évolution. Les tribunaux ajustent leur interprétation en fonction des réalités changeantes du monde du travail[2].
Jugements rendus par les tribunaux inférieurs
Le TAT, saisi de la contestation de la succession de M. Batzibal, conclut en 2023 que le décès ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la LATMP.
Pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail » selon l’article 2 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (LATMP)[3], le Tribunal administratif du travail (TAT) analyse l’ensemble des circonstances entourant celui-ci, en faisant une pondération de (six) 6 critères élaborés par la jurisprudence[4] :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- Le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
Le TAT reconnaît que l’accident est imprévu et soudain, mais estime que la réparation du pneu n’est pas une activité connexe au travail d’ouvrier agricole. Il est précisé que l’intervention du travailleur a eu lieu sur les terrains de l’employeur, mais en dehors des heures normales de travail. De plus, la réparation du pneu ne pouvait pas être considérée comme une activité que l’employeur aurait pu attendre de manière implicite ou accessoire ni en lien avec les fonctions habituelles de M. Batzibal en tant qu’ouvrier agricole ou chauffeur désigné. La tâche n’était ni demandée par l’employeur ni habituelle dans l’entreprise, dans la mesure où il engageait un garage professionnel pour effectuer ce type de réparation, puis elle n’était pas utile à l’accomplissement du travail. Le TAT insiste sur l’absence de lien de subordination, de rémunération, et sur le fait que d’autres véhicules étaient disponibles, concluant que l’acte de M. Batzibal relevait d’une initiative personnelle sans lien avec ses fonctions[5].
La Cour supérieure, en janvier 2024, a confirmé cette décision du TAT, jugeant qu’elle était raisonnable, cohérente et conforme à la jurisprudence applicable à la notion d’« accident survenu à l’occasion du travail » selon la LATMP. Appliquant la norme de la décision raisonnable, le juge a reconnu que l’accident s’était produit hors des heures de travail, sans rémunération, bien que sur les lieux de travail, et que l’employeur n’avait donné aucune directive à M. Batzibal pour effectuer la réparation du pneu, laquelle ne constituait ni une activité connexe ni une fonction attendue du travailleur. Il a également souligné l’absence de coutume ou d’attente de l’employeur à cet égard, et précisé que le TAT n’avait pas utilisé un critère erroné de nécessité, mais l’avait évoqué à titre illustratif. Enfin, le juge a rejeté l’argument selon lequel le TAT aurait interprété de manière trop restrictive la notion « à l’occasion du travail », estimant que la Succession cherchait en réalité une réévaluation du dossier, ce qui excède le cadre du contrôle judiciaire [6].
L’arrêt de la Cour d'appel
La juge Dutil rappelle que le litige porte sur la question de savoir si le TAT a rendu une décision déraisonnable en concluant que le travailleur n’est pas décédé à l’occasion de son travail, au sens de l’article 2 de la LATMP.
Elle procède à un rappel de l’évolution législative en matière d’accidents du travail, ainsi que des principes d’interprétation qui s’y rattachent. Elle s’attarde notamment à l’interprétation de l’expression « à l’occasion de son travail », telle qu’établi dans l’arrêt Montreal Tramways rendu par la Cour suprême en 1920, dont les enseignements demeurent toujours pertinents et suivis aujourd’hui :
« On constate que la Cour suprême adopte dès lors une interprétation large et libérale de la loi visant à indemniser les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Pour qu’il y ait lésion professionnelle « à l’occasion du travail », l’accident n’a pas à être étroitement relié aux tâches du travailleur. Il est suffisant que le lien soit « plus ou moins étroit à l’exercice de la profession de la victime » ou que l’activité soit « un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement ». Le message de la Cour suprême est clair, il faut favoriser une interprétation large et libérale afin d’accomplir l’objectif réparateur de cette loi qui possède un caractère éminemment social. Il s’agit d’une loi d’ordre public »[7].
[Nos soulignements; références omises]
En outre, l’article 351 LATMP indique que les décisions doivent être rendues suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas[8].
La juge Dutil estime que plusieurs des critères ci-haut identifiés ne posent pas de difficulté d’interprétation et d’application, en raison des faits de l’affaire. Ce sont plutôt ceux relatifs à la finalité de l’activité exercée par le travailleur et au caractère de connexité et d’utilité relative qui soulèvent problème, puisqu’ils ont conduit le TAT à conclure que l’accident s’est produit dans la sphère des activités personnelles du travailleur[9].
Elle souligne que le TAT n’a pas tenu compte de la preuve démontrant que M. Batzibal était un chauffeur désigné des véhicules de l’employeur, tant durant les heures de travail qu’à l’extérieur de la journée normale de travail. Elle rappelle en outre qu’il avait déjà participé à des réparations, notamment celle d’une première crevaison survenue le jour même de l’accident, laquelle visait à lui permettre de retourner effectuer des travaux d’irrigation. La preuve révèle que l’employeur formait parfois ses travailleurs à la mécanique, et que la réparation tentée aurait pu être utile à l’entreprise. Bien que ce type de réparation soit généralement confié à des garagistes professionnels, il n’en demeure pas moins qu’un lien avec le travail, plus ou moins étroit, pouvait exister. Comme elle le précise :
« […] bien que le TAT retienne que le type de réparation tentée par M. Batzibal était généralement effectuée par des garagistes professionnels, ce constat est étranger à la recherche d’un lien de connexité avec le travail. Il ne démontre que l’absence d’un lien direct. Il ressort en outre clairement de la preuve que de petites réparations, par exemple celle effectuée l’après-midi même sur la Caravan par M. Fortin, pouvaient être faites à la ferme. »[10].
La Cour d’appel considère que l’erreur du TAT réside dans sa conclusion, selon laquelle la réparation du pneu ne présentait aucune raison apparente, en lien avec le travail ou les obligations du travailleur, justifiant qu’il procède au changement du pneu crevé, plutôt que d’utiliser un autre véhicule pour retourner au village.
La Cour souligne que le TAT n’a pas respecté les règles d’interprétation applicables à la LATMP, notamment le principe d’interprétation large et libérale exigé par la jurisprudence. Il a recherché un lien direct entre l’accident et les fonctions exercées, ignorant que la loi permet de reconnaître un accident « à l’occasion du travail » même s’il n’est pas directement causé par celui-ci[11].
La juge Bich souscrit à la conclusion de la juge Dutil. Elle ajoute que le TAT a omis de considérer un élément fondamental du dossier : le contexte particulier de M. Batzibal, travailleur agricole étranger résidant sur les lieux ou à proximité du travail, dans un logement fourni par l’employeur. Ce cadre de vie, intrinsèquement lié à l’emploi, crée une forme de dépendance — voire de mainmise — de l’employeur sur plusieurs aspects de la vie privée du travailleur. Cette réalité brouille la frontière entre vie personnelle et professionnelle, rendant inadéquate une simple distinction fondée sur les heures de travail. Selon la juge Bich, ce contexte devait impérativement être pris en compte pour apprécier si l’accident survenu lors de la réparation du pneu présentait un lien « plus ou moins étroit » avec le travail, comme l’exige la LATMP. En l’ignorant, le TAT a écarté à tort la possibilité que cette réparation, bien qu’effectuée hors des heures de travail, puisse être utile à l’accomplissement des fonctions professionnelles de M. Batzibal, notamment en tant que chauffeur désigné[12].
Bref, la Cour d’appel conclut que le TAT a commis des erreurs révisables en ignorant des éléments de preuve pertinents et en appliquant une interprétation trop restrictive de la loi. Elle propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et la décision du TAT. Elle déclare que le décès de M. Batzibal constitue une lésion professionnelle, et retourne le dossier à la CNESST pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité[13].
La position dissidente de la juge Manon Savard
La juge en chef Manon Savard, en désaccord avec ses collègues, propose de rejeter l’appel et de confirmer la décision du TAT. Elle rappelle que le rôle du juge en contrôle judiciaire est limité à l’évaluation de la raisonnabilité de la décision administrative, sans substituer son propre jugement[14]. Selon elle, le TAT a suivi une démarche cohérente et logique, en appliquant les critères jurisprudentiels pour déterminer si l’accident était survenu « à l’occasion du travail » au sens de l’article 2 de la LATMP[15].
Elle estime que le TAT n’a pas imposé un critère plus exigeant de « nécessité », mais a plutôt évalué correctement l’« utilité relative » de l’activité exercée par M. Batzibal au moment de l’accident[16].
La juge Savard souligne que, contrairement à ses collègues, le TAT n’a pas exigé un lien direct entre l’accident et les tâches spécifiques du travailleur. Plutôt que de se limiter aux fonctions attribuées ou potentiellement demandées par l’employeur, le TAT a analysé l’ensemble du contexte de travail, incluant les pratiques de la ferme, les attentes envers les employés et les fonctions exercées par tous. Il a conclu que le changement de pneu relevait d’une initiative personnelle sans lien, direct ou indirect, avec le travail. L’analyse du TAT visait à établir si l’accident était survenu « à l’occasion du travail », et non « par le fait du travail », comme le confirme sa démarche [17]. La juge Savard estime donc qu’il serait erroné de prétendre que le TAT exigeait une preuve d’un lien de causalité direct entre l’accident et les tâches de M. Batzibal.
Elle conclut que le TAT n’a ni ignoré la preuve ni commis d’erreur manifeste, et que sa décision est raisonnable au regard des faits et du droit applicable[18].
Elle rejette également l’idée que le TAT aurait interprété la LATMP de manière restrictive. Au contraire, elle affirme que le tribunal a adopté une approche large et conforme à l’esprit réparateur de la loi[19]. Malgré la précarité des travailleurs agricoles, elle rappelle que l’indemnisation ne peut être accordée que si l’accident survient « à l’occasion du travail »[20].
Que retenir de cette décision ?
L’arrêt de la Cour d’appel envoie un message clair aux employeurs : la notion d’« accident à l’occasion du travail » est interprétée de manière large et contextuelle. Même une activité exercée hors des heures normales, sans directive explicite de l’employeur, peut être reconnue comme liée au travail si elle présente une utilité relative ou une connexité avec les fonctions du salarié, plus particulièrement lorsque l’employeur en retire un bénéfice.
Les employeurs doivent donc être conscients que leur encadrement, leurs pratiques et les conditions de vie qu’ils offrent à leurs travailleurs — notamment les travailleurs migrants — peuvent élargir leur responsabilité en cas d’accident.
Cette décision rappelle que les tribunaux n’hésitent plus à tenir compte des réalités sociales et professionnelles, y compris la précarité et la dépendance des travailleurs étrangers agricoles. Le fait que M. Batzibal résidait sur les lieux de travail, utilisait un outil défectueux de l’employeur et agissait potentiellement dans l’intérêt de l’entreprise en dehors des heures de travail a suffi à établir un lien suffisant avec le travail.
En somme, cette affaire illustre que la frontière entre vie personnelle et professionnelle peut être floue, surtout dans des contextes de travail atypiques. Les employeurs doivent faire preuve de vigilance et de prévoyance : toute activité exercée par un salarié, même spontanée, peut être interprétée comme relevant du travail, si elle est effectuée dans un cadre où l’employeur exerce une forme de contrôle ou en retire un bénéfice.
Les employeurs doivent donc revoir leurs politiques internes, leurs pratiques de supervision et leur gestion des équipements pour éviter que des initiatives personnelles ne se transforment en responsabilités légales imprévues. Il devient impératif pour les employeurs de renforcer leur approche en matière de prévention des accidents de travail, en mettant en place des mécanismes clairs de gestion des risques, des formations ciblées en prévention et une définition précise des rôles et responsabilités.
Notre équipe spécialisée en droit du travail et de l’emploi se fera un devoir de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions concernant vos droits et obligations.
Vous pouvez communiquer avec nous pour toute question.
[1] Lares Batzibal (Succession de) c. Les Cultures Fortin inc., (31 juillet 2025), (Cour d’appel) 200-09-010729-249.
[2] Sylvain CHABOT, Kevin MINVILLE, Florence ST-PIERRE, « À l'occasion du travail : les tribunaux modifient-ils leur approche en fonction des nouvelles réalités du monde du travail? », Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2025), Service de la formation continue du Barreau du Québec, EYB2025DEV354.
[3] RLRQ c A-3.001.
[4] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012; Boucher et Sureté du Québec, C.L.P. 256875-04B-0503; Métro Richelieu Fruits et Légumes et Hendericx, 2011 QCCLP 3663.
[5] Succession de Batzibal et Cultures Fortin inc., 2023 QCTAT 597, par. 8 et 15-22.
[6] Voir à cet effet la décision de la Cour supérieure : Succession de Lares Batzibal c. Tribunal administratif du travail, 2024 QCCS 157.
[7] Lares Batzibal (Succession de) c. Les Cultures Fortin inc., préc., note 1, par. 46.
[8] Id. par. 52.
[9] Id., par. 59.
[10] Id., voir les par. 65-69.
[11] Id., par. 72-74.
[12] Id., par. 94.
[13] Id., par. 85-87.
[14] Id., par. 98-101.
[15] Id., par. 106-107.
[16] Id., par. 108-116.
[17] Id., par. 117-120.
[18] Id., par. 123-128.
[19] Id., par. 129-134.
[20] Id., par. 134.