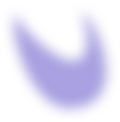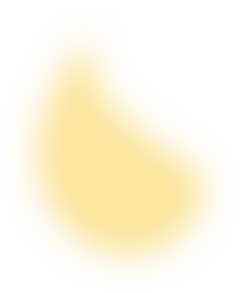Introduction
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail 1 (LSST), les employeurs ont l'obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs 2. Cette responsabilité comprend la mise en place de mesures pour prévenir, protéger les travailleurs exposés à des situations de violence psychologique, physique ou à caractère sexuel, et faire cesser de tels comportements.
Le nouvel article 515.1 du Code de procédure civile rend davantage accessible l'option aux employeurs, notamment d'émettre une ordonnance de protection, leur permettant ainsi de mieux agir afin de protéger un salarié.
L'obligation de protection de l'employeur
Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 59, la Loi sur la santé et la sécurité du travail impose aux employeurs québécois une obligation de protéger la santé psychologique des travailleurs, incluant les situations de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel qui surviennent en dehors du cadre professionnel3 . L'employeur est tenu de prendre ces mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
D'abord, l'article 51(6) prévoit que les entreprises qui emploient vingt (20) personnes et plus doivent se doter d'une approche structurée dans l'utilisation de méthodes et techniques permettant d'identifier, contrôler et surtout éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs, dont les risques psychosociaux.
L'article 51(16) LSST est particulièrement intéressant, puisqu'il élargit l'obligation de l'employeur à des situations se déroulant en dehors du travail4 :
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment :
[...]
16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel et prendre toute autre mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel.
Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d'une situation de violence conjugale ou familiale, l'employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
(Notre soulignement)
Cette obligation s'étend également aux comportements des tiers (fournisseurs, clients, etc.) qui interfèrent avec le travail.
L'employeur ne peut invoquer la vie privée pour s'abstenir d'agir. Il doit évaluer les risques liés à l'environnement de travail, adapter les conditions de travail si nécessaire et doit collaborer avec des ressources externes au besoin.
Cette obligation implique la mise en place de mesures concrètes, notamment un plan de sécurité individuel, le contrôle d'accès, l'adaptation du lieu de travail ou encore un devoir de sensibilisation des salariés.
Le défaut d'intervention peut engager la responsabilité civile de l'employeur, une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et même une réclamation pour lésion professionnelle.
Le recours judiciaire : un outil juridique à la disposition de l'employeur
A. L'injonction
La décision récente Boulangerie Canada Bread ltée c. Therrien5 a reconnu la possibilité pour un employeur d'obtenir une injonction permanente contre un ancien salarié, devenu un tiers pour l'employeur, ayant des comportements menaçants envers ses anciens collègues. Cette décision a confirmé que l'employeur pouvait agir en justice pour protéger un employé, même si la source de la conduite harcelante provenait de la sphère privée.
Pour obtenir une injonction, l'employeur doit démontrer :
- L'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable ;
- L'absence de solution raisonnable par d'autres moyens ;
- Que l'injonction est nécessaire pour assurer la sécurité des employés6 .
Cette démarche peut être envisagée en parallèle d'un plan de sécurité interne, et en collaboration avec les autorités policières.
B. L'ordonnance de protection
En 2022, la décision Trivium Avocats inc. c. Rochon 7 a été la première décision à appliquer l'article 51(16) LSST. Dans cette décision, l'employeur a demandé une ordonnance de protection afin de protéger son employée victime de violence familiale, dans un contexte où le fils d'une employée l'appelait sur les lieux de son travail plusieurs fois par jour pour la menacer, l'intimider et exiger de l'argent. Dans ces circonstances, l'employée était perturbée et n'arrivait plus à exercer ses fonctions. La Cour supérieure a reconnu que l'employeur devait agir dans un contexte de violence familiale qui intervenait dans le milieu de travail, et que ce devoir pouvait justifier l'ordonnance de protection.
Il est toutefois intéressant de noter dans cette décision que les ordonnances recherchées par l'employeur et accordées par le tribunal interviennent toutes dans le milieu de travail, et impliquent de ne pas se présenter sur les lieux de l'immeuble où se situent les bureaux, ne pas entrer en contact avec la victime durant les heures de travail et ne pas entrer en contact avec un employé, en tout temps, dans le but de communiquer avec la victime.
Le 4 juin dernier est entré en vigueur l'article 515.1 du Code de procédure civile, qui se lit comme suit :
515.1. L'ordonnance de protection est une ordonnance enjoignant à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique qui craint que sa vie, sa santé ou sa sécurité ne soit menacée, notamment en raison d'un contexte de violence basée sur une conception de l'honneur, de violence familiale, conjugale ou sexuelle, d'intimidation ou de harcèlement.
L'ordonnance de protection peut être demandée au moyen d'un exposé présentant sommairement les faits allégués ou au moyen du formulaire établi par le ministre de la Justice.
Elle peut également être demandée, si la personne craignant la menace y consent ou si le tribunal l'autorise, par une autre personne ou par un organisme.
[...]
(Nos soulignements)
D'ailleurs, le non-respect d'une ordonnance de protection constitue une infraction criminelle8.
Cet article vient encadrer de façon plus détaillée l'ordonnance de protection qui existait sous les articles relatifs à l'injonction (art. 49, 58 et 509 C.p.c.). Ainsi, alors que l'article 509, al. 2 C.p.c. permettait d'émettre une ordonnance de protection pour « protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée », l'article 515.1 C.p.c. permet l'émission d'une telle ordonnance pour « protéger une autre personne physique qui craint que sa vie, sa santé ou sa sécurité ne soit menacée ».
Il est possible de faire un parallèle avec l'article 810 du Code criminel9, qui permet à une personne qui craint pour des motifs raisonnables qu'une autre personne la blesse ou endommage sa propriété, de déposer une dénonciation devant un juge de paix. Cette dénonciation peut aussi être déposée par une autre personne agissant en son nom, par exemple un proche ou un intervenant. La différence notable avec l'article 515.1 C.p.c. est que le consentement de la personne qui éprouve la crainte est nécessaire au dépôt de la dénonciation.
Le Journal des débats parlementaires précise que le critère pour obtenir une ordonnance de protection est moins élevé que le critère de l'injonction, qui prévoit l'obligation de faire la démonstration de la violence. En matière d'ordonnance de protection, le critère est désormais celui de la crainte, qui sera évalué par le tribunal selon un critère objectif (portrait global de la situation) et subjectif (en fonction de la personne, sa perception). Le fardeau de preuve est d'ailleurs moins élevé qu'en matière de harcèlement criminel.
Les débats parlementaires ne font aucunement mention de l'alinéa 3 de l'article 515.1 C.p.c. et il n'a pas encore été interprété par les tribunaux. Ainsi, il n'y a pas de réponse claire à savoir si l'employeur pourrait agir de son propre gré afin de demander une ordonnance de protection dans la sphère purement privée d'une employée ou d'un employé.
Réflexion
À notre avis, il serait possible pour un employeur de demander une ordonnance de protection en vertu de l'article 515.1 C.p.c. s'il a connaissance d'une crainte pour la vie, la santé ou la sécurité d'un employé. Cette interprétation s'inscrit dans une tendance initiée par le législateur au cours des dernières années, où ce dernier attribue des responsabilités de plus en plus grandes aux employeurs pour remédier à des enjeux de société émanant de la sphère privée de leurs employés, dont la violence familiale et conjugale. En effet, le législateur consacre désormais le milieu de travail, endroit où les travailleuses et travailleurs passent le plus clair de leur temps, comme un endroit privilégié pour s'attaquer à certains fléaux de la société, telle la violence familiale et conjugale.
Il demeure difficile d'anticiper de manière concrète les interventions d'un employeur dans une situation où un salarié entièrement en télétravail serait victime de violence de nature conjugale ou familiale.
Or, il convient de rappeler que l'employeur n'a pas besoin d'avoir la certitude que l'employé est victime de violence conjugale ou familiale. En effet, son obligation prend naissance dès qu'il sait ou qu'il devrait raisonnablement savoir que son employé est exposé à cette violence 10 . Par conséquent, un employeur qui, par exemple, remarque des signes de violence physique sur l'un de ces employés devrait alors intervenir afin que cesse cette violence. Il en irait de même pour des soupçons de violence psychologique, qu'elle soit conjugale ou familiale.
Peu importe la personne à l'origine du harcèlement, l'employeur devra prendre les moyens raisonnables afin d'éradiquer le harcèlement. Finalement, il sera intéressant d'évaluer la manière dont les tribunaux interpréteront la portée de cette obligation de l'employeur à l'aune de l'ordonnance de protection du nouvel article 515.1, alinéa 3 C.p.c. Par exemple, nous pouvons nous demander si une omission par un employeur de demander l'émission d'une telle ordonnance, alors que ses conditions d'ouverture sont satisfaites, pourrait être interprétée comme un manquement de la part de ce dernier et engager sa responsabilité.
Conclusion
L'obligation de l'employeur en matière de sécurité psychologique s'est considérablement élargie au Québec au cours des dernières années. La reconnaissance de la violence conjugale comme un risque professionnel impose une vigilance accrue et une capacité d'intervention renforcée. La possibilité de recourir à des moyens judiciaires, comme l'injonction et l'ordonnance de protection, illustre cette transformation du rôle de l'employeur, consacré désormais acteur de protection sociale.
Les employeurs doivent désormais intégrer ces dimensions dans leurs pratiques afin de garantir un environnement de travail sécuritaire et conforme aux exigences légales.
Notes de bas de page
- RLRQ, c. S-2.1.
- Art. 9 LSST.
- Art. 51(16) LSST.
- L'article 1 LSST prévoit aussi l'étalement de l'obligation au télétravail.
- 2024 QCCS 4047, EYB 2024-556464.
- Art. 509 à 511 C.p.c.
- 2022 QCCS 4628, EYB 2022-500925.
- Art. 127 C.cr. ; R. c. Gibbons, 2012 CSC 28, EYB 2012-207448.
- L.R.C. (1985), ch. C-46.
- Art. 51, al. 2 LSST.