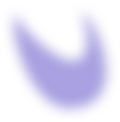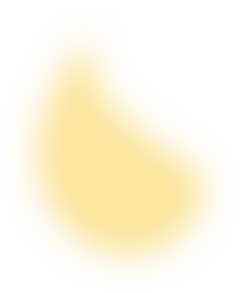VEILLE LÉGISLATIVE
CANADA
PARCS CANADA
SANTÉ CANADA
ACTUALITÉ
TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE
- La Colombie-Britannique veut renforcer la souveraineté alimentaire des Premières Nations
- Les Mohawks de Kahnawake et la reconquête (écologique) de leur territoire
- « Notre territoire ne doit pas devenir un dépotoir radioactif »
- First Nations sick of Sask. government's 'trinkets and beads' approach to resource development: Opposition
- Leaders of northern First Nations rally at Queen's Park against Ontario's mining push
JUSTICE, POLICE ET PENSIONNATS
- Camp Marcedes : des mains et des messages peints sur le bâtiment du QG de la police
- Enfants autochtones : l’entente de 23 milliards de dollars approuvée par le Tribunal
- En C.-B., la Nation Gitxsan récupère des terres qui avaient été cédées à Ottawa
- Pour un meilleur accès aux archives des pensionnats pour Autochtones
- Aucun lien entre de potentielles tombes anonymes et des activités criminelles, dit la GRC
- This fight overcompensation for First Nation kids has been raging for 14 years. On Monday, it’s back in court
- Canada trying to save money at the expense of First Nations kids, lawyer argues
- Northern Saskatchewan First Nations calling for immediate action on police reform
POLITIQUE, ÉLECTION ET GOUVERNANCE
- Gary Anandasangaree devient ministre des Relations Couronne-Autochtones
- Des chefs autochtones espèrent que le nouveau ministre suivra les traces de Marc Miller
- L’Assemblée des chefs du Manitoba regrette le départ de Marc Miller
- La Première Nation Carry The Kettle paie le prix pour des problèmes de gouvernance
- Fouille de dépotoir : une députée de Winnipeg demande l’aide des Nations unies
- Chiefs continue to press feds on its land back and NRTA shortcomings
- Kill the bill, say First Nations as they unite in opposition to Métis self-governance legislation
- Whitecap Dakota First Nation moves toward self governance
ÉDUCATION, LANGUE, SOCIAL ET CULTURE
- Une murale pour militer et faire découvrir les paysages de la Saskatchewan
- Un an après les excuses du pape, des communautés autochtones attendent réparation
ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT
SANTÉ ET SÉCURITÉ
- Nombreuses réductions de services dans les dispensaires de la baie d’Hudson
- Plusieurs obstacles à l’avortement pour les Autochtones, selon une étude canadienne
VEILLE JURISPRUDENTIELLE
pieds-planche— épinette blanche— revendicatrices— traduction— réserve
Revendication se rapportant à la cession illégale du bois d’épinette blanche provenant de la réserve indienne no 106A qui a eu lieu en 1904. Dans cette décision, le juge Whalen a conclu que la Couronne avait, dans six cas, manqué à son obligation de fiduciaire envers les revendicatrices. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, mais soutient que le juge Whalen a commis une erreur en écrivant que le bois en question avait été dûment cédé puisque, par sa réponse à la déclaration de revendication, la Couronne avait reconnu que la cession était invalide. La cour a invité le Tribunal à « prendre acte du fait que la Couronne a reconnu que la cession de bois de 1904 ne respectait pas les exigences législatives pertinentes » de l’Acte des Sauvages.
projet— ke— peuples autochtones— milieux humides— tracé
Le 8 juillet 2022, Hydro-Québec a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie du Canada visant la ligne d’interconnexion Hertel-New York. Les Premières Nations Anishnabeg ont fait valoir que la production, les modifications à la production et l’accroissement de la production ont une incidence directe sur leurs activités traditionnelles, et que le fait d’autoriser le projet sans tenir compte de cette incidence aura des effets négatifs sur leurs droits constitutionnels. Toutefois, les répercussions décrites par les Premières Nations ne se rapportent qu’aux installations de production en amont existantes. L’obligation de consulter s’applique à la décision aux présentes et non à des décisions antérieures. La Commission conclut que les Premières Nations Anishnabeg n’ont porté à son attention aucun nouvel effet directement lié au projet.
R. c. T.P., 2023 QCCQ 4821 (CanLII)
peine— accusé— autochtones— contrevenant— infractions
Jugement de détermination de la peine à la suite du verdict de culpabilité pour agression sexuelle sur une jeune fille autochtone de son entourage. Le Tribunal a considéré non seulement l’origine autochtone de M. P..., mais également le fait qu’il a été personnellement affecté par les facteurs systémiques et historiques et lui a attribué un degré de responsabilité morale moindre. Le Tribunal accorde la peine proposée par le ministère public. Il considère que celle-ci constitue la juste peine à imposer à M. P. Cette peine reflète la gravité de l’infraction, les torts causés à la victime et à la communauté, tout en étant proportionnelle au degré de responsabilité morale de l’accusé qui s’est vu atténuée par l’application des facteurs Gladue.
Roseau River First Nation v. Canada (Attorney General), 2023 FCA 163 (CanLII)
Administrative law— Judicial review— Grounds of review— Procedural fairness
Appel à la cour fédérale concernant le Projet d’une ligne internationale de transmission traversant le territoire du Treaty 1. Dans l'ensemble, la Cour doit considérer le processus de consultation comme un tout pour voir s'il y a eu des efforts raisonnables d'information, de consultation et d'accommodement. L'accent est mis sur le processus et sur la question de savoir si des efforts raisonnables ont été déployés, et non sur le résultat substantiel. Dans l'ensemble, les preuves montrent que les éléments d'information et de réponse de l'obligation de consultation ont été respectés. Les préoccupations et les intérêts du Treaty 1 ont été pris en compte, véritablement examinés dans le cadre d'un dialogue bilatéral, et certains aménagements ont été apportés. L'obligation de consultation a été remplie.
fiabilité— accusé— préc— grand-mère— committing thereby the indictable offence
Requête de type Khelawon. Il est question de savoir si les verbalisations d’une victime et son enregistrement vidéo sont admissibles en preuve en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire qui repose sur la nécessité et la fiabilité. Le poursuivant demande au Tribunal de prendre en compte, par analogie, les facteurs de l’arrêt Gladue pour évaluer le critère de la nécessité à l’égard d’une jeune fille autochtone. La Commission Viens documente la difficulté pour les femmes de témoigner. Craignant en plus d’être stigmatisées par leurs pairs, les victimes sont souvent terrifiées de raconter leur histoire devant un groupe de personnes qu’elles ne connaissent pas. La combinaison de tous ces éléments explique l’absence de X à la Cour. Il ne s’agit pas ici d’un refus de collaborer ou d’une indifférence. Le Tribunal conclut que le critère de la nécessité est satisfait.